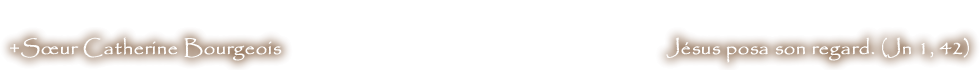C’est une affirmation devenue banale, à force d’être répétée, que la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin est le chef-d’œuvre de la pensée humaine mise au service de la Foi. De ce chef-d’œuvre, ainsi que s’exprime le P. Lacordaire, « tout le monde en parle, même ceux qui ne le lisent pas, comme tout le monde parle des Pyramides, que presque personne ne voit ». (Mémoire pour la restauration en France des Frères Prêcheurs, ch. IV.) Mais parmi ceux-là, parmi ceux qui n’ont jamais lu la Somme de saint Thomas et qui en parlent, professant pour elle la plus vive admiration, il en est beaucoup, nous le savons, qui voudraient ne pas se contenter de cette admiration stérile. Ils voudraient pouvoir lire la Somme, la goûter, en jouir. Un double obstacle les en empêche. Pour quelques uns, pour un grand nombre dans le monde, c’est la langue. La Somme théologique est écrite en latin ; et nous n’en sommes plus au temps où le latin était la langue savante de tous les esprits cultivés. L’usage du latin dans le monde va de plus en plus en diminuant. Si bien que tout ouvrage non écrit en langue moderne devient pour beaucoup un livre fermé. Même pour ceux qui entendent le latin, c’est souvent un repos d’esprit, une facilité de travail de pouvoir retrouver en leur langue à eux les pensées des grands génies qui ont nourri le monde de leur doctrine. Pour tous, un second obstacle, plus difficile encore à surmonter (car on avait essayé, ces derniers temps, par des traductions plus ou moins heureuses, de lever le premier), consiste en la marche, ou la méthode, disons, si l’on le veut, le style de la Somme théologique. On n’est plus fait à ce style, à cette marche ; et si l’on entend les mots, le sens de la phrase, pourtant si claire, et si lumineuse, et si pleine, demeure obscur, ou plutôt voilé et enveloppé. Il y a une écorce qu’il faudrait briser ; sans cela, impossible d’atteindre et de saisir la moelle. – C’est à lever ce double obstacle et, partant, à faciliter la lecture de la Somme théologique pour ceux, très nombreux, qui désireraient s’initier par eux-mêmes et directement à l’œuvre par excellence du génie humain, que nous avons voulu nous appliquer en entreprenant ce travail. Nous ne nous dissimulons pas la grandeur de la tâche. Elle est ardue ; elle est immense. Mais nous l’entreprenons avec confiance, espérant tout du secours divin et de la protection de saint Thomas.
On n’attend pas de nous que nous entrions ici dans de longs développements sur la Somme théologique. Il y faudrait des volumes et on n’épuiserait pas le sujet. Nous nous contenterons de rappeler brièvement ce qu’il est indispensable de savoir sur saint Thomas, qui en est l’auteur, sur les circonstances dans lesquelles il composa son œuvre, sur la place que la Somme théologique a occupée et doit continuer d’occuper dans le monde des intelligences et dans l’Église, sur l’esprit et la méthode avec lesquels nous aborderons et poursuivrons son étude.
I. Saint Thomas d’Aquin et son œuvre1Certains titres ne figurent pas dans l’édition originale et ont été ajoutés pour faciliter la lecture.
Saint Thomas naquit d’une race princière, au château des comtes d’Aquin, à Roccasecca, en Italie, non loin de Naples2Nous emprunterons les détails biographiques qui suivent à Guillaume de Tocco, le premier historien du saint, et à Échard, le grand archiviste de l’Ordre de Saint-Dominique.. On n’est pas fixé sur la date précise de sa naissance. Les uns marquent l’année 1224 ; d’autres, plus probablement, l’année 1226, ou même 1227. Dès l’âge de cinq ans, il fut confié aux moines bénédictins du Mont-Cassin. C’est là que tout enfant il étonnait ses maîtres par une maturité d’esprit exceptionnellement précoce, leur posant déjà cette question, dont ses écrits nous disent qu’elle devait être la passion de toute sa vie : Qu’est-ce que Dieu ? Envoyé à Naples pour y parfaire ses études, il se lia d’affection avec les premiers frères du couvent dominicain de cette ville. Bientôt, il entrait chez eux et demandait, comme une grâce, de revêtir les blanches livrées de leur Ordre. Ses parents, ses Frères surtout, ne purent se résigner à ce qu’ils estimaient une déchéance pour leur famille ; et ils mirent tout en œuvre, jusqu’à la violence, pour détourner le jeune Thomas de sa vocation. Ils l’enfermèrent dans la tour d’un château de leur père et l’y retinrent pendant toute une année, recourant même à une tentation infâme dont la vertu du saint jeune homme sortit miraculeusement récompensée par les anges. Thomas utilisa les loisirs de sa prison pour se familiariser avec la lettre de l’Écriture sainte et d’Aristote, qu’il apprit, l’une et l’autre, en plusieurs de leurs livres, à peu près par cœur. Il posait ainsi les bases ou les fondements de sa future synthèse.
Au sortir de sa prison et remis en liberté, il se hâta d’aller à Rome rejoindre ses Frères, les enfants de saint Dominique. Le général de l’Ordre l’envoya, avec un autre Frère, à Cologne, pour y suivre les leçons d’Albert-le-Grand. Le maître ne tarda pas à deviner le génie de son disciple ; et l’on sait la parole prophétique dont il vengea celui que des condisciples peu clairvoyants appelaient, par raillerie, le bœuf muet de Sicile : – Laissez, répondait Albert ; car un jour ce bœuf muet remplira le monde de ses mugissements. Lorsque Albert dut quitter Cologne pour se rendre à Paris, Thomas l’y suivit. C’était là, d’ailleurs, dans cette grande Université de Paris, qui était dès lors et qui devait rester pendant tout le Moyen-âge le foyer de lumière le plus intense et le plus répandu, que saint Thomas allait inaugurer et poursuivre sa carrière de professeur et de maître en Doctrine sacrée. Ses débuts furent marqués par un petit opuscule, qui n’a guère plus de vingt pages de nos livres d’aujourd’hui et où se trouve, en germe, toute l’œuvre doctrinale dont la Somme théologique devait être l’apogée et le développement magnifique. Ce petit opuscule a pour titre : De ente et essentia ; de l’être et de l’essence. Il touche aux questions les plus délicates de la logique, de la philosophie naturelle, de la métaphysique ; et en quelques mots, d’une précision et d’une netteté qui n’ont d’égale que la profondeur de la doctrine, saint Thomas y résout ces éternels problèmes des universaux, de la composition des corps, de la nature des esprits, de l’attribut primordial de Dieu, avec une telle sûreté de coup d’œil, qu’il n’aura jamais, non pas même dans la Somme théologique, à y apporter la plus petite, la plus légère modification. On pourrait dire de cette première œuvre de saint Thomas qu’elle est déjà la Somme théologique en raccourci. Or, saint Thomas, quand il l’écrivit, était à peine âgé de vingt-quatre ans3Cf. de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, 2e édit., 1905, p. 328 – Nous ne saurions trop recommander la lecture de cet excellent ouvrage, qui constitue la meilleure introduction historique à l’étude de la Somme de saint Thomas..
Depuis lors et jusqu’au moment où il entreprendrait la Somme, saint Thomas ne cessa de vaquer aux occupations doctrinales qui devaient être, dans les desseins de Dieu, la raison de sa vie. Il débuta par le commentaire du Manuel classique d’alors, le livre des Sentences de Pierre Lombard. Puis, et vers l’âge de trente ans, il écrivait, à la prière et sur les instances de B. Raymond de Pennafort, ce premier chef d’œuvre, qui fut immédiatement traduit dans toutes les langues, y compris le grec et l’hébreu, et qui eut été le chef-d’œuvre de l’esprit humain, si la Somme théologique n’était venue après. Nous avons nommé la Somme contre les Gentils. Entre temps, et après des difficultés de toute nature où n’étaient point étrangers certains sentiments peu nobles provoqués par la gloire croissante des Ordres mendiants, saint Thomas fut fait Maître en théologie de l’Université de Paris.
Il commença, dès lors, à enseigner comme Maître. Et ce furent, à partir de ce moment, des travaux sans nombre, écrits à la requête des particuliers, des communautés religieuses, des généraux d’Ordre, des Universités, des chefs d’État, des souverains Pontifes eux-mêmes, venant tous consulter celui qui brillait au firmament de l’Église comme un soleil éblouissant. Là se placent le traité de la vie religieuse contre Guillaume de Saint-Amour, le traité de l’unité de l’intelligence contre Averroès, le traité contre les Juifs, le traité du gouvernement des princes et une multitude d’opuscules sur toutes sortes de questions philosophiques et théologiques. Bientôt, il entreprenait, à la prière du Pape, ce livre prodigieux qu’on a peine à comprendre qu’il ait pu être l’œuvre d’un seul homme, et au Moyen-âge surtout, où les instruments du travail intellectuel étaient loin d’être ce qu’ils sont aujourd’hui : la Chaîne d’or, commentaire littéral et mystique des quatre Évangiles, où le texte est formé exclusivement de citations patristiques faites avec un art et une science qui laissent l’esprit dans une sorte de stupeur. Saint Thomas nous y fait entendre près de quatre-vingts Pères ou Docteurs de l’Église latine et grecque, dont tous viennent déposer en faveur de la doctrine traditionnelle et éclairent, par leur parole autorisée, le texte de l’Évangile. En même temps, et devant continuer ce travail pendant qu’il écrirait la Somme théologique, saint Thomas commentait successivement divers livres de l’Écriture sainte, notamment le livre de Job, les Psaumes, le livre d’Isaïe, l’Évangile de saint Matthieu, l’Évangile de saint Jean, les Épîtres de saint Paul et les principaux traités d’Aristote sur la Logique, la Physique, l’Âme, la Métaphysique, l’Éthique, la Politique. Il écrivait aussi les Questions disputées et les Quodlibeta ou Mélanges.
Il avait alors quarante ans. Il ne lui en restait plus que neuf à vivre. C’était l’heure marquées par Dieu pour l’éclosion de l’immortel ouvrage que toutes les autres œuvres de saint Thomas avaient eu pour effet de préparer. La Somme théologique allait être écrite, qui occuperait le faîte des temps chrétiens et serait tout ensemble l’aboutissement des travaux qui avaient précédé et le point de départ de ceux qui suivraient, inspirant tout ce qu’il y aurait de bon et de sain comme doctrine jusqu’à la fin des temps.
II. La Somme théologique
Les conditions dans lesquelles la Somme théologique fut écrite nous montrent bien qu’en effet et dans les desseins de Dieu cette œuvre devait résumer les travaux qui avaient précédé et conserver, porté à sa plus haute puissance, tout ce qu’il y avait eu de solidité et de pureté doctrinale dans les écrits des Pères, des Docteurs et des philosophes. Du reste, cette affirmation qu’il pourrait, au premier abord paraître paradoxale, n’est pas de nous. Elle est du pape Léon XIII. Dans son Bref du 4 août 1880, par lequel il institue saint Thomas patron de toutes les Écoles catholiques, il nous dit que « la Doctrine de saint Thomas est d’une telle plénitude qu’elle comprend, à l’instar d’une mer, toute la sagesse venue des anciens. Tout ce qui a dit de vrai ou discuté discuté sagement par les philosophes païens, par les Pères et les Docteurs de l’Église, par les hommes éminents qui ont fleuri avant lui, non seulement il l’a connu à fond, mais il l’a accru, parfait, disposé avec une telle clarté de langage, avec un art si consommé dans la discussion, avec une telle propriété de termes, qu’il a bien laissé à ceux qui viendraient après lui la faculté de l’imiter, mais qu’il semble leur avoir enlevé toute possibilité de le surpasser ». Et dans l’Encyclique Æterni Patris, faisant sienne une parole de Cajétan, le même Pontife nous dit que « saint Thomas, pour avoir professé une souveraine vénération à l’endroit des Docteurs sacrés, a en quelque façon hérité de leur génie », au point qu’à l’entendre lui seul, et à le lire, on entend tous les grands hommes qui l’avaient précédé. C’est ce qui avait fait dire à un autre Pontife, le pape Jean XXII, qu’on gagne plus en un an, dans la lecture de saint Thomas, qu’en toute une vie dans la lecture des autres auteurs. Et, traduisant sous une autre forme cette même pensée, le cardinal Casanate avait fait inscrire, par mode de sentence dans la bibliothèque de la Minerve, à Rome : « En vain liriez-vous tous les livres, si vous ne lisez Thomas d’Aquin ; et si vous le lisez lui seul, c’est assez ; il vous suffit. » [Cf. Didiot, Saint Thomas d’Aquin, p. 181 ; Desclée, 1894.]
Dieu avait admirablement disposé toutes choses pour que saint Thomas fût digne d’un tel rôle. En même temps qu’il le douait de facultés si excellentes, qu’au témoignage de ses premiers historiens, il lui suffisait de lire un livre une seule fois pour en saisir le vrai sens, si caché qu’il pût être, et pour en retenir jusqu’aux mots et aux formules, il le faisait naître en un siècle où le règne de la Foi était à son apogée et où l’envol de la pensée humaine allait, sur les ailes de Thomas, s’élever si haut qu’il est à désespérer de le voir jamais monter davantage » (Encyclique Æterni Patris). Point de ces maladies de l’esprit et de la raison, en ces temps de merveilleuse santé intellectuelle, qu’on a appelées depuis le scepticisme, le dilettantisme ou même le criticisme. Et quelle ferveur, quel entraînement, quel enthousiasme, quelle passion pour les travaux de l’intelligence, pour ces sublimes spéculations philosophiques et théologiques qui laissent si froids aujourd’hui ou si indifférents nos esprits uniquement occupés du terre à terre des recherches positives ! On se pressait alors en foules si compactes aux leçons des maîtres en renom, qu’on était obligé de laisser des locaux devenus trop étroits, et qu’on s’en allait sur les places publiques assister à des cours comme ceux d’Albert-le-Grand. C’était aussi le moment où les œuvres d’Aristote étaient révélées au monde occidental dans leur totalité et dans la pureté de leur texte. – Thomas d’Aquin – ses œuvres à lui en font foi – a eu de ces œuvres d’Aristote une connaissance si complète et une si parfaite intelligence, que le plus moderne des interprètes du grand philosophe grec – M. Barthélémy Saint-Hilaire — n’hésitait pas à déclarer, a-t-on dit, que quiconque voulait avoir le vrai sens d’Aristote devait le demander à saint Thomas4Nous n’avons point trouvé, dans les œuvres de M. Barthélémy Saint-Hilaire, le texte même de cette parole qu’on lui prête. Mais on voit qu’il avait lu attentivement les Commentaires de saint Thomas et il le cite plusieurs fois pour éclairer la pensée du Stagyrite..
Or, sait-on bien ce qu’est l’œuvre d’Aristote et quel merveilleux secours elle devait apporter dans la création de la synthèse doctrinale qu’allait être la Somme théologique. Savant, d’une observation universelle et jamais en défaut ; logicien si sûr et si parfait, que la logique, depuis lui, n’a pas avancé d’un pas ; métaphysicien hors de pair, à ce point qu’il semble avoir pour jamais fixé la métaphysique comme il avait fixé la logique ; moraliste si éclairé et politique si sage, que la morale évangélique a pu faire siens la plupart de ses préceptes, – Aristote nous apparaît, dans son œuvre, comme le génie le plus vaste, le plus pondéré, le mieux fait pour unifier et équilibrer les diverses branches du savoir humain. Sans doute, le savoir humain a fait des progrès depuis Aristote, mais il n’a fait de progrès qu’en restant dans les lignes que ce puissant génie lui avait tracées. Dès là qu’il a voulu sortir de ces lignes et les briser, il s’est égaré lui-même et n’a plus cultivé que l’erreur. Bien plus, nous oserions dire que la synthèse du savoir humain ne pouvait être faite qu’au moment où elle l’a été par Aristote. Les diverses branches du savoir humain étaient alors assez accusées pour qu’on en pût saisir les contours et la puissance de direction ; elles n’étaient pas trop développées, chacune en sa direction propre, comme elles le sont aujourd’hui, pour rendre impossible à un seul génie, si vaste qu’on le suppose, le regard d’ensemble et de détail qui constitue la synthèse. Quel serait donc aujourd’hui l’homme assez puissant pour être à même de nous donner la synthèse autorisée de toutes les branches du savoir humain ? Quel serait l’homme qui pourrait être tout ensemble un Pasteur en biologie, un Berthelot en chimie, un le Play en sciences sociales ? on n’ose dire : un Kant en philosophie, parce que la philosophie de Kant ne saurait être tenue pour la vérité philosophique et qu’il est d’autres philosophes avec lui qui se disputent le sceptre des intelligences. Aristote, au contraire, a été, à lui seul, le savant le mieux informé de son temps, le moraliste et le sociologue le plus sûr, le philosophe à ce point transcendant et dominateur, qu’aujourd’hui encore sa doctrine philosophique est la doctrine de tous les esprits qui n’ont pas rompu en visière soit avec le bon sens, soit avec l’Église catholique. – Il s’ensuit qu’une synthèse doctrinale voulant rapprocher les unes des autres, pour en montrer l’harmonie, les données de la raison et de la foi, ne pouvait s’appuyer sur une base plus solide, en ce qui est de la raison, que sur l’œuvre d’Aristote.
On objecte qu’une partie de cette œuvre, celle notamment qui a trait aux sciences naturelles, devait nécessairement vieillir, et que la synthèse doctrinale appuyée sur elle, en sera, pour autant, défectueuse. – Cette objection, grave au premier abord, est plus spécieuse que solide. Il est très certain que les sciences d’observation, en ce qui est du détail des phénomènes, et aussi les applications pratiques qu’elles comportent, sont de nature à se perfectionner indéfiniment. Mais parce que les observations qui suivent sont plus détaillées et plus précises, il n’en résulte pas nécessairement que les observations qui ont précédé n’aient point été exactes. Encore moins s’ensuivra-t-il que les spéculations philosophiques, édifiées sur ce qu’on pourrait appeler les observations à la portée de tous et d’expérience usuelle, doivent être infirmées par les compléments d’expérience qu’apporteront le nombre des observateurs ou les instruments de précision. Il y a une philosophia perennis, une philosophie qui ne passe pas, non seulement en métaphysique et en logique, mais jusque dans l’observation des choses de la nature. Et c’est précisément cette philosophie qui ne passe pas, cette philosophie du bon sens, qu’on trouve à un degré exceptionnel dans les écrits d’Aristote. C’est elle que saint Thomas a su y découvrir et sur laquelle il s’appuie. – Lors donc qu’il édifiera sa synthèse doctrinale, en prenant pour base l’œuvre philosophique d’Aristote, saint Thomas ne nous manifestera une connaissance expérimentale du monde de la nature aussi détaillée, aussi minutieuse, aussi raffinée que nous la retrouvons dans les livres de science qui se publient de nos jours. Il est évident qu’il ne nous parlera ni d’oxygène, ni d’hydrogène, ni encore moins de rayons X ou de télégraphie sans fil. Mais est-ce un si grand mal, et faut-il donc tant nous en plaindre ? Pour être vulgaires ou moins « savants », ses exemples en seront-ils moins vrais, moins à notre portée ? Il n’est pas absolument nécessaire de connaître la composition chimique de l’air, de l’eau ou du feu, pour savoir que le feu brûle, que l’eau rafraîchit, que l’air est transparent. Or, c’est de ces propriétés manifestes pour tous, que saint Thomas, après Aristote, use le plus souvent, soit à titre de comparaison, soit pour édifier ses théories rationnelles du monde de la nature. Si donc il y a une part nécessairement caduque dans l’œuvre d’Aristote, on peut dire que cette part n’a déteint que d’une façon très secondaire et sans grande importance dans la synthèse doctrinale de saint Thomas. La partie principale de cette œuvre, la partie philosophique ou rationnelle, demeure vraiment ce que nous l’avons définie, la base la plus solide et tout à fait inébranlable, sur laquelle pouvait et devait s’édifier la synthèse définitive de la raison et de la Foi. Rien ne pouvait donc mieux préparer, au point de vue rationnel, l’œuvre de saint Thomas ; et ce n’est pas un vain mot ou une simple formule plus ou moins banale, de dire que la résurrection des écrits d’Aristote avait eu, pour l’œuvre qui allait s’accomplir, quelque chose de vraiment providentiel.
D’autre part, où trouver des conditions meilleures pour puiser à bonne source les données de laFoi, que ce grand treizième siècle saturé d’enseignement traditionnel au point qu’on semblait alors respirer cet enseignement comme on respirait l’air pur et vif qui animait les corps ? On oppose, il est vrai, que les sciences historico-critiques n’avaient pas reçu alors le développement qu’elles ont aujourd’hui ; et d’aucuns en voudraient conclure que les données de la Foi n’avaient pas au temps de saint Thomas la fixité et la précision sans lesquelles toute synthèse édifiée dessus est nécessairement ruineuse. Que veut-on dire par là ? Que saint Thomas n’a point connu l’Écriture sainte, ainsi que les Pères et les Docteurs, ou qu’il n’en a pas eu le vrai sens ? Mais il savait l’Écriture sainte par cœur ; et nous avons vu qu’il en avait commenté les principaux livres. Or, ces commentaires que nous avons entre les mains, révèlent une connaissance très exacte et une intelligence parfaite du sens littéral de l’Écriture. Non pas que, pour certains détails de littérature ou d’histoire notre connaissance de l’Écriture ne soit aujourd’hui plus éclairée, mais n’oublions pas qu’il ne s’agit là que de détails, ou, si l’on le veut, du cadre qui entoure la pensée substantielle de nos saints Livres. Quant à cette pensée substantielle elle-même, à ce qu’on pourrait appeler la vérité dogmatique et morale de l’Écriture, à ce qui en est la révélation divine au sens le plus formel de ce mot, nous pouvons dire, sans crainte d’exagération ou d’erreur, que nul jamais ne l’a mieux possédée que saint Thomas.
Nous en dirons autant, proportions gardées, de la connaissance que nous révèlent des Pères de l’Église les œuvres du saint Docteur. Il est tout à fait certain qu’à l’époque où il vivait on n’avait pas pour étudier les Pères la facilité que nous avons aujourd’hui. On n’avait ni collections complètes comme l’est celle de Migne, ni éditions critiques établissant avec un soin jaloux l’authenticité et la fidélité des textes. S’ensuit-il qu’on ne pût pas étudier les Pères ou qu’on n’en pût pas avoir une connaissance suffisamment exacte ? Pour plusieurs des Pères, et c’était les principaux, on en possédait intégralement les œuvres maîtresses. En outre, il circulait, dès lors, des collections de textes patristiques, des sortes de chaînes qui livraient sous formes de pensées les principaux passages des auteurs ecclésiastiques et qui permettaient d’avoir la moelle, la substance doctrinale de ces divers auteurs. Saint Thomas a su tirer un parti excellent soit de ces collections, soit des diverses œuvres qu’il a pu avoir sous la main. À la différence de plusieurs de nos contemporains qui ont de très riches et très complètes collections, éditées selon toutes les règles de la critique, mais les lisent peu ou pas du tout et en parlent souvent sur la loi d’autrui, se donnant, à peu de frais comme travail, des airs de savants très avertis, saint Thomas lisait et connaissait, dans leur substance, toutes les œuvres qu’il avait sous la main. Nous en avons comme preuve son admirable Chaîne d’or où il cite, probablement de mémoire, pour bon nombre de cas, près de quatre-vingts Pères de l’Église ou auteurs ecclésiastiques ; et aussi les multiples citations qu’il fait des Pères dans ses divers ouvrages, notamment dans la Somme théologique où il apporte leur témoignage avec un à-propos, une précision et une sûreté d’information, à rendre jaloux bon nombre de nos critiques les plus contemporains5Cf. P. Gardeil, Revue thomiste, 1903, pp. 197-215 ; 428-457.
Il n’est donc pas douteux que saint Thomas a pu avoir une connaissance matérielle très suffisante des documents de la Foi. Ajoutons qu’il en a eu l’intelligence comme peu d’hommes l’ont jamais eue. C’est ce que nous avons déjà noté au sujet de sa connaissance de l’Écriture. Nous pouvons le dire aussi de sa connaissance des autres documents. Pour bien lire ces documents, en effet, il ne suffit pas de ce qu’on appelle aujourd’hui l’esprit critique. Il y faut aussi, et plus encore, l’esprit de foi, qui comprend le sens général des affirmations divines et le sens de la tradition ecclésiastique. Or, nul doute que saint Thomas ne fût, sur ce point, au treizième siècle, dans des conditions pour le moins égales à celles où se trouvent aujourd’hui tant de chercheurs, même parmi les plus en vue, et non pas seulement dans le monde hétérodoxe, qui vont, sous prétexte de critique et d’histoire, jusqu’à ébranler ou à compromettre ce qu’il y a de plus fondamental et de plus essentiel dans les témoignages qui portent notre Foi.
Soit donc qu’il s’agisse de l’élément rationnel, soit qu’il s’agisse de l’élément surnaturel et divin, nous devons convenir que saint Thomas a paru dans des circonstances admirablement préparées pour l’œuvre doctrinale qu’il devait réaliser. Avec cela, où trouver une raison plus sûre, un esprit plus pondéré, un génie tout ensemble plus compréhensif et plus apte à l’analyse ? Si bien qu’il semble que Dieu avait tout disposé en saint Thomas, avant lui et autour de lui, pour qu’en elle ce puissant génie réalisât l’œuvre qui serait l’œuvre définitive de la synthèse doctrinale où viendraient s’éclairer, jusqu’à la fin, toutes les générations qui devaient suivre.
III.
Et n’est-ce pas ainsi, en effet qu’on a considéré l’œuvre de saint Thomas dans l’Église ? Il vivait encore, et déjà les souverains Pontifes prônaient l’excellence de son enseignement. Lorsque, trois ou quatre ans après sa mort, quelques Frères plus turbulents qu’éclairés voulurent attaquer sa doctrine, l’Ordre de Saint-Dominique leur infligea un blâme public, appelant leur conduite « un scandale ». L’année d’après, en 1279, le chapitre général de l’Ordre enjoignit, de la façon la plus expresse, qu’on ne tolérât jamais la moindre parole irrévérencieuse touchant la personne du Frère Thomas ou ses écrits. En 1286 s’ajoute l’ordre formel, adressé à tous et à chacun, « de promouvoir efficacement, dans la mesure de leur science et de leur pouvoir, la doctrine du vénérable Maître Frère Thomas d’Aquin, de précieuse mémoire ». On devra promouvoir sa doctrine, et non seulement la promouvoir, mais encore « la défendre, du moins à titre d’opinion, saltem ut est opinio ». Quiconque oserait faire ou soutenir le contraire, qu’il soit Maître, Bachelier, Prieur ou tout autre, sera très sévèrement puni et suspens ipso facto de tout office dans l’Ordre. En même temps qu’on expliquait le Maître des Sentences, on devait lire aux élèves quelques articles de celui qui n’était encore considéré que comme le commentateur du seul Maître, mais qui était le commentateur par excellence, celui dont les explications faisaient loi. Il en fut ainsi pendant les deux siècles qui suivirent sa mort. Et nous voyons, par le grand ouvrage de Capréolus, jusqu’à quel point, dans l’Ordre de Saint-Dominique, on vivait de la pensée de Thomas d’Aquin6Cf. P. Pègue, Revue thomiste, 1899, pp. 507-529.
On en vivait à ce point, non seulement dans l’Ordre de Saint-Dominique, mais dans l’Église, que lorsque se tinrent les grandes assises du concile de Trente, les Pères du Concile voulurent qu’à côté de l’Écriture sainte fût placée, sur le même autel, la Somme de saint Thomas. Le pape Léon XIII, après avoir rappelé que déjà « aux conciles de Lyon, de Vienne et de Florence, l’on dirait que Thomas avait assisté aux délibérations et aux décrets des Pères et que presque il les avait présidés, comme il devait le faire de nos jours, au concile du Vatican, luttant avec une force invincible et un merveilleux succès contre les erreurs des Grecs, des hérétiques et des rationalistes », parle comme il suit du fait du concile de Trente : « Mais la gloire par excellence de Thomas d’Aquin et qui lui est tout à fait propre, car nul autre des Docteurs catholiques ne la partage avec lui, c’est que les Pères du concile de Trente voulurent qu’au milieu même du conclave qui allait se tenir, en même temps que le texte des divines Écritures et les décrets des souverains Pontifes, la Somme de Thomas d’Aquin fût ouverte sur l’autel, d’où l’on tirerait des conseils, des raisons, des oracles. » (Encyclique Æterni Patris.) Cet acte si grave du concile de Trente était comme l’indication de la volonté divine marquant la place qu’occupait déjà et que devrait occuper toujours, dans l’enseignement catholique, de préférence à tout autre livre humain, la Somme théologique. L’on ne s’y trompa point dans le monde des théologiens et des docteurs. C’est à partir de ce
moment que la Somme de saint Thomas remplace partout, dans les collèges et dans les universités, le livre des Sentences et devient le manuel classique de renseignement. Tous les Maîtres désormais s’appliqueront à commenter et à expliquer la Somme. On a estimé à plus de six mille le nombre des commentaires écrits et connus de la Somme théologique. [Cf.. Didiot, Saint Thomas d’Aquin, édit. 1894, préface.] C’est autour de ce livre qu’a rayonné et que s’est développé, comme autour d’un foyer intense tout ce qu’il y a eu de lumière et d’enseignement théologique dans l’Église. Le catéchisme lui-même n’est que l’abrégé de la Somme. El il s’est trouvé, par un privilège unique, que la pensée de saint Thomas est devenue la pensée même du monde chrétien.
Il n’en faudrait pas plus pour nous convaincre que la Somme théologique n’est nullement destinée à vieillir et à être remplacée ou supplantée par de nouveaux livres d’enseignement. La doctrine de la Somme étant la doctrine même de l’Église, comme évidemment la doctrine de l’Église ne changera pas, la doctrine de la Somme non plus n’aura pas à changer. S’il pouvait y avoir quelque doute là-dessus, et si par un faux sentiment de ce qu’on est convenu d’appeler les besoins de l’esprit moderne, il en était qui eussent quelque appréhension de se mettre à l’école d’une doctrine qui remonte à sept cents ans, nous nous permettrions de faire observer que ce n’est pas nécessairement une condition d’excellence, pour une doctrine, que la note et le caractère de nouveauté. Dans l’Étape de Paul Bourget, le héros du livre, Jean Monneron, moitié pour se distraire des préoccupations qui l’affolent, moitié pour s’occuper, prend le Timée de Platon et tombe sur ce passage : « Alors, dans ce temple de Saïs, entouré par le Nil, un des plus avancés en âge parmi les prêtres, dit au voyageur : – O Solon, vous autres, Grecs, vous serez toujours des enfants, et il n’y a pas un Grec digne du beau nom de vieillard. – Et Solon demanda : – Que veux-tu dire? – Que vous êtes trop jeunes quant à vos âmes, répondit le prêtre. Vous n’y possédez aucune vieille doctrine transmise par les aïeux, aucun enseignement donné de siècle en siècle par des têtes blanchies. » C’est qu’en effet il n’est pas de meilleure recommandation, pour une doctrine, que celle qui lui vient de l’épreuve des siècles. Quand celte doctrine n’est elle-même que le plus pur extrait de ce qu’il y a eu de meilleur dans les âges passés – qui ont été par excellence les dépositaires et les interprètes de la foi ou l’expression la plus parfaite du génie humain – et qu’elle a mérité les suffrages, l’adhésion sans réserve des plus grands penseurs qui ont suivi, bien plus la consécration solennelle de l’autorité constituée la gardienne officielle de la vérité dans le monde, comment n’être pas pleinement et a tout jamais rassurés sur sa valeur transcendante et son éternelle durée ?
Or tel est, nous l’avons vu, le cas de la Somme théologique. Ce n’est pas seulement pour sa solidité et sa mystérieuse grandeur que l’œuvre de saint Thomas a pu être comparée aux pyramides ; c’est aussi pour sa durée qui domine les siècles. Écrite ou édifiée il y a sept cents ans, cette œuvre remonte, par les matériaux qui la composent et l’esprit qui l’a formée, aux âges les plus lointains de la pensée humaine et de la pensée divine. C’est le monument par excellence de la raison et de la Foi se donnant le baiser d’une alliance indissoluble dans les bras de la Tradition. Et c’est pourquoi, au contraire de ceux qui, plus attirés vers la nouveauté, s’exposent, de nos jours, au reproche d’être « trop jeunes quant à leurs âmes », nous sommes, nous, les amants passionnés de cette vieille doctrine que nous ont transmise de siècle en siècle nos aïeux à la tête blanchie.
IV.
Ce n’est pas à dire toutefois, comme on s’est plu à nous le reprocher, que nous soyions les ennemis-nés de tout renouvellement et de tout progrès dans le travail de la raison et de l’enseignement humain. Nul plus que nous n’est disposé à approuver et à seconder ce renouvellement et ce progrès. Il peut d’autant moins nous déplaire que son champ d’action n’est pas le même que le nôtre. Il se déploie et s’étend à côté ou tout autour, nullement au même lieu et en la même place. Plus on fera de découvertes dans le domaine de l’histoire et dans celui des sciences naturelles ou d’observation expérimentale, plus on dégagera de toute imprécision ou de toute obscurité, soit les livres de l’Écriture sainte, soit les documents de la tradition ecclésiastique, plus nous y applaudirons ; car ce sont les avenues de notre propre palais que l’on élargit et que l’on rend plus princières; c’est d’un plus grand éclat que l’on tait briller la solidité de ses fondements et l’harmonieuse beauté de ses proportions. Nous aimons les vieux murs qui nous abritent et les admirables pièces qui règnent si harmonieusement distribuées à l’intérieur ; mais si pour mieux jouir de la campagne transformée et fécondée par les incessants labeurs des hommes de peine, nous devons élargir quelques meurtrières, ou même percer quelque ouverture, ou encore créer autour du palais, des galeries nouvelles, même au risque d’arracher le lierre parasite qui a tapissé les murs, très volontiers nous le ferons.
Il y a aussi un autre progrès – et doctrinal celui-là – qui consiste à résoudre les questions nouvelles que pose chaque jour le développement de la vie individuelle, économique ou sociale. Mais comment ce progrès pourrait-il nous déplaire, puisqu’il n’est rien autre que l’application, aux questions nouvelles, des éternels principes mis en lumière si vive dans la Somme de saint Thomas ?
Que si l’on voulait étendre cette idée de progrès jusqu’à modifier dans leur teneur essentielle les données de la tradition dogmatique, ou encore jusqu’à remplacer, dans l’explication rationnelle des dogmes, l’ancienne philosophie péripatéticienne et scolastique par une philosophie plus au goût de nos contemporains, et, comme on l’a dit, substituer au vêtement vieilli taillé dans la philosophie d’Aristote, un vêtement plus moderne, taillé, par exemple, dans la philosophie kantienne, – nous nous contenterions de répondre par cet extrait de l’Encyclique Æterni Patris :
« Toutes les fois que nous appliquons notre esprit à l’excellence, à la vertu, aux fruits merveilleux de cet enseignement philosophique tant aimé de nos Pères, nous estimons comme une témérité et une faute qu’on ne lui ait pas conservé partout et toujours l’honneur qui lui revenait, alors surtout que la philosophie scolastique avait pour elle un usage éprouvé, l’approbation des plus grands esprits, et, ce qui prime tout, le suffrage de l’Église. Au lieu de cette antique doctrine s’est implantée, ici et là, une certaine nouvelle méthode philosophique, qui n’a pas porté les fruits désirables et salutaires que l’Église et la société civile elle-même auraient voulu. À la faveur des novateurs du seizième siècle, on s’est plu à philosopher sans tenir aucun compte de la foi demandant et s’accordant tour à tour la faculté de penser au gré et selon les caprices de la raison. De là vint bientôt que se multiplièrent d’une façon désordonnée les systèmes de philosophie et qu’on vit paraître les sentiments les plus divers et souvent les plus contraires sur les sujets qui intéressent au plus haut point la vie humaine. La multitude des sentiments ne tarda pas à enfanter l’hésitation et le doute : et chacun sait que du doute à l’erreur, pour l’esprit humain, il n’y a qu’un pas. – Ce goût de la nouveauté, précisément par ce que les hommes cèdent facilement à l’instinct de l’imitation, a gagné, en maint endroit, l’esprit des philosophes même catholiques ; et ceux-ci, obéissant à un conseil peu sage, non sans préjudice pour les sciences, ont délaissé le patrimoine de l’antique sagesse et préféré ourdir des nouveautés plutôt que d’accroître et de parfaire l’ancien par le nouveau. Un tel système d’enseignement, qui n’a pour point d’appui que l’autorité et la raison de maîtres particuliers, repose sur un fondement muable, et pour ce motif ne donne pas une philosophie solide, stable et forte, comme l’était l’ancienne, mais changeante et sans portée. – Aussi bien, conclut Léon XIII, il est tout à fait nécessaire de garder, pour la théologie, la méthode, si grave des scolastiques, afin que la révélation et la raison s’y prêtant un mutuel concours, cette science continue d’être, suivant le mot de Sixte V, le boulevard inexpugnable de la foi. »
Nous aimerons à reproduire le témoignage de Sixte V, auquel Léon XIII fait ici allusion, et qui disait, dans sa bulle Triumphantis (en 1588) : « C’est par un don spécial de Celui qui seul communique l’esprit de science, de sagesse et d’intelligence, et qui, à travers les siècles, selon qu’il en est besoin, enrichit son Église de nouveaux bienfaits et la munit de nouvelles défenses, qu’a été élaborée par nos anciens, hommes très sages, la Théologie scolastique, dont surtout les deux glorieux Docteurs saint Thomas et saint Bonaventure, par leur génie hors de pair, par leur étude assidue, par leurs travaux et leurs veilles, ont fixé la méthode et les doctrines, livrant à la postérité leurs enseignements magnifiques. La connaissance et la pratique constante d’une science si salutaire qui nous vient des sources très abondantes des saintes Lettres, des souverains pontifes, des saints Pères et des conciles a toujours été du plus grand secours à l’Église, soit pour entendre et interpréter les Écritures elles-mêmes dans un sens vrai et pur, soit pour lire et expliquer les Pères sans danger et avec fruit, soit pour découvrir et réfuter les diverses erreurs ou hérésies. Aujourd’hui surtout, ajoutait
33